Un oubli. Le poème Hallali a été publié dans Lichen d’août 2020. A lire ici ou dans la revue. C’est un poème qui me tient particulièrement à coeur…

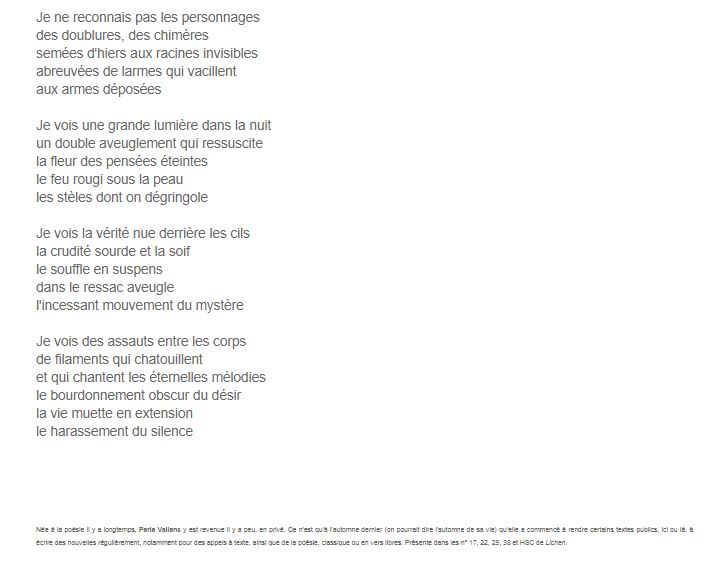
Il n'y a pas d'âge pour rêver, vivre et écrire ses rêves…

Un oubli. Le poème Hallali a été publié dans Lichen d’août 2020. A lire ici ou dans la revue. C’est un poème qui me tient particulièrement à coeur…

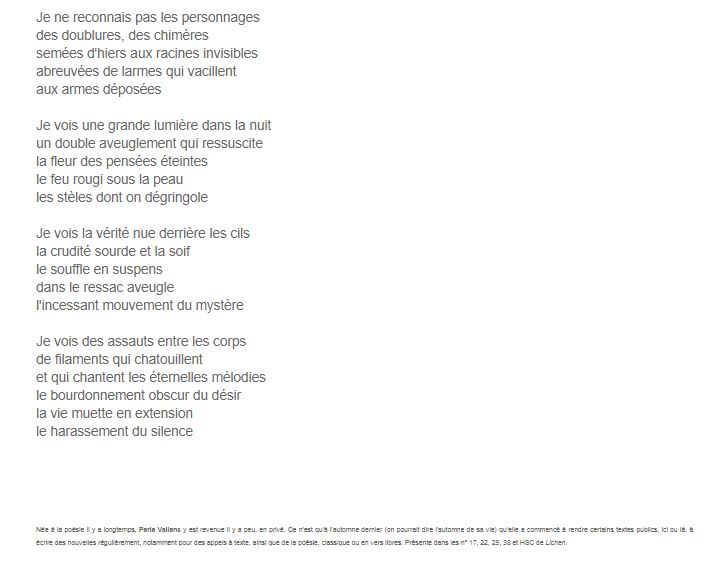

Au viseur, voir loin, par-delà l’ossature, par-delà l’espace clos et les jointures, par delà les possibilités. Voir avec précision, avec suffisamment de persistance et d’acuité, exercer son sens de l’observation, son sens de l’à-propos, de l’à-coup, de l’accélération imprévue des événements, sans transition, sans déperdition des détails. Voir avec clarté la désinvolture, l’absence d’objectif, la démesure de la désolation. Voir et se garder d’interpréter, se laisser imprégner par ce qui est vu. Il faut basculer de côté. Il faut garder ses distances, biaiser le regard. Il faut répartir les sensations, les laisser émerger, pointes d’iceberg à la surface, les suivre, les installer en soi, durablement. Il faut apprendre la lenteur, ralentir le temps et l’espace entre l’envol et l’atterrissage. C’est ce que font les oiseaux pour laisser le moins de plumes possible.
©Perle Vallens

Le pied se pose toujours au bon endroit, celui du nouveau pas, du bon passage, du passé au présent. Il se pose à la bonne place. Il tient son rôle. Il le connaît par cœur depuis le temps. Le pied connaît la leçon. Il connaît la chanson depuis qu’il a deux ans. La mélodie n’a pas changé. Il faut dérouler. Il faut chanter le déséquilibre provoqué, l’art de se rattraper, la maîtrise des orteils, l’assurance du talon. Le pied connait bien la marche à suivre.
Parfois, le pied aurait besoin d’une béquille, d’une semelle orthopédique pour réparer l’incertitude du pas. Le pied qui hésite renvoie à quelque chose d’ancien, quelque chose d’enfance. Le pied hésite à passer le cap, à passer le pas. Il hésite à s’aventurer. Il a sans doute peur de l’incertain, de l’à peu près. Le pied n’aime pas les surprises, ni les entorses. Il suppose qu’il peut rester encore un peu immobile avant de se poser plus loin. Il s’imagine que le chemin peut venir à lui. Le pied change d’avis en fonction de l’aspect de la route. Il a besoin d’un minimum de confort, d’un peu de confiance. Il a besoin d’assise et de stabilité, il a besoin de prendre une grande inspiration avant d’avancer.
Le pied n’avance pas masqué, il se pose franchement, bien à plat, ventre à terre. Finalement, il faut se jeter à l’eau sinon on fait du sur place.
©Perle Vallens

Ta bouche n’est pas vraiment une bouche. C’est à la fois une porte, une serrure et une clé. C’est une entrée et une sortie. C’est une route secondaire. C’est une aire d’autoroute.
C’est une paire de ciseaux. Ce qui coupe et ce qui est coupé. Ce qui mord et ce qui est mordu. Ce qui mâche, ce qui est mâché. C’est une arme à double tranchant.
Ta bouche, c’est un radiateur pour les hivers trop longs. C’est la braise et la cheminée, la chaleur du corps, le feu qui circule à l’intérieur, qui couve dans la trachée, qui tranche le froid au couteau.
La morsure de l’air se travaille mâchoire dégagée, ouverte sur l’inconnu. L’incision fait couler ce qui reste de vie entre les dents. Desserre, ouvre, dévore. Les bouches entravées ne sont bonnes qu’au silence.
©Perle Vallens

Elle fait la planche, elle fait la morte, elle fait le compte de ses années. Tout cela n’est pas si long, tout cela est peut-être un jeu.
Elle fait une offrande. Elle s’offrirait sans contrepartie pour un peu d’amour et de considération. Elle s’offrirait bien des vacances, très loin de toute réalité.
L’eau accueille ses cheveux. C’est déjà une offrande. C’est déjà un gage de bonne conduite. Les alevins votent pour. Les poissons se méfient. Ils restent toujours à l’écart, ils restent à l’ombre des rochers, ils restent en sous-marin, en sous-main des basses besognes.
Elle flotte en surface, ses cheveux coulent. Un jour, elle les coupera pour de bon.
Elle souffle par la bouche et le nez, elle souffre comme les animaux. Elle s’offre encore un peu tant qu’il fait jour.
Elle se baigne dans l’eau sale. L’eau de vaisselle, l’eau délavée, l’eau vaste qui sait la contient toute, l’eau qui sait l’emprisonner.
Un jour, elle se laissera baigner, laver de tout. Un jour, elle se noiera entièrement dans la vie.
©Perle Vallens

Le corps s’impose. Il pèse. Il précise ses contours. Il déjoue les illusions. Il se désigne. Il se dessine de mémoire.
Le corps devise souvent avec lui-même. Il cause coeur et âme, veines et os, pieds et poings, lié de l’intérieur, acteur de son propre jeu, ouvrier de sa propre chute.
©Perle Vallens

Le corps n’est ni ami ni ennemi mais il nie toute proximité de près ou de loin.
Il passe des accords qu’il ne respecte pas. Il fait scission, il préfère.
Il prend ses distances. Je le prends par mes sentiments. Il me prend de haut. A force aucun ne prend l’autre au sérieux.
Il héberge le temps d’une vie. Il rompt de façon unilatérale tout contrat passé à la naissance.
Le corps est comme ça, dilettante, divergent, disruptif.
Il est l’habitant unique.
©Perle Vallens

Rivage blanc sans ombre
sage de la sagesse de mort
Le semblant de la pluie ne lave rien
L’eau déplace les troncs et les os
un peu en deçà du corps
au-delà du coeur blanchi
du sang imparfait
©Perle Vallens

Qui du verre ou du visage absorbe le mieux la lumière, qui reflète le mieux les souvenirs ?
La transparence se jauge à l’œil grand ouvert. Elle se mesure au degré de réflexivité des ondes, par vagues successives, invisibles, inconsistantes. Les ondes noient le poisson. Les ondes boivent la tasse. Elles se voient dans l’œil en face.
Les ondes s’inquiètent de frapper la bonne surface. L’espace se fait mince entre la paroi et la pupille. Une lame de rasoir qui couperait l’image en deux. Une pour toi, une pour moi. A chacun son souvenir. A chacun son sourire.
L’usure du regard trouble toujours un peu plus l’objet regardé, qui se fond, qui se fane. Il va bientôt disparaître.
Les vitres finissent toujours par se briser si le regard insiste.
©Perle Vallens

Prendre de la distance c’est mettre une distance entre soi et le reste.
La distance se parcourt de façon inversée. Elle éloigne. Elle ne se place pas au hasard. Elle mesure ses pas de retrait, à rebours, à rebrousse poil. Attention au recul, à la sécheresse désertique du sol que l’on quitte lorsque l’on se quitte soi-même.
On risque le glissement de terrain. Sémantique assoiffée de toujours plus de mots. Le réconfort de ses vieux jours. Les mots incompris, les mots incompatibles, les mots insalubres, les mots infaillibles.
Les mots qui dérapent et glissent en dehors de leur sens. Les mots qu’on ramasse à la petite cuillère, bouillie de petits mots dans la bouche. Bouillon de culture que l’on peine à recracher.
Mots indécis qui tournent innombrables dans la bouche. Mots incapables d’en sortir.
Mots encrassés qu’écrasent des mauvaises habitudes. Mauvais sort jeté aux premiers mots, premiers nés de la langue, les mots maudits.
Mots cheveu sur la soupe. Mots cheveu sur la langue. Mots qui encombrent, mots qui se cabrent entre les lèvres, chevaux indomptés, mes mots d’amour pires qu’une pochade. Mots pochette surprise expulsés un à un, langue de belle mère. Mots confettis jusque dans mon lit, mots confisqués à la bouche cousue.
Mots doux à la petite semaine. Mots minuscules à peine audibles, mots adipeux qui en ont gros. Mots dissidents, mots décidés, mots placides au quant à soi bien placé à l’extérieur.
Mais, quand les mots consentent, ils ne disent mot.
©Perle Vallens