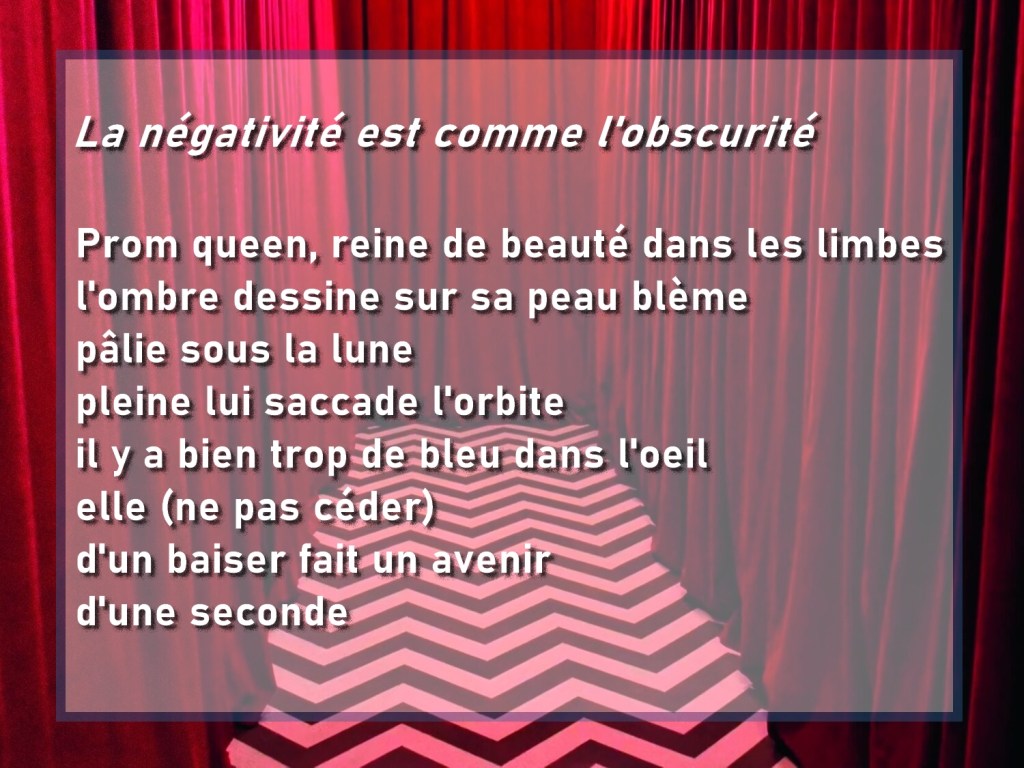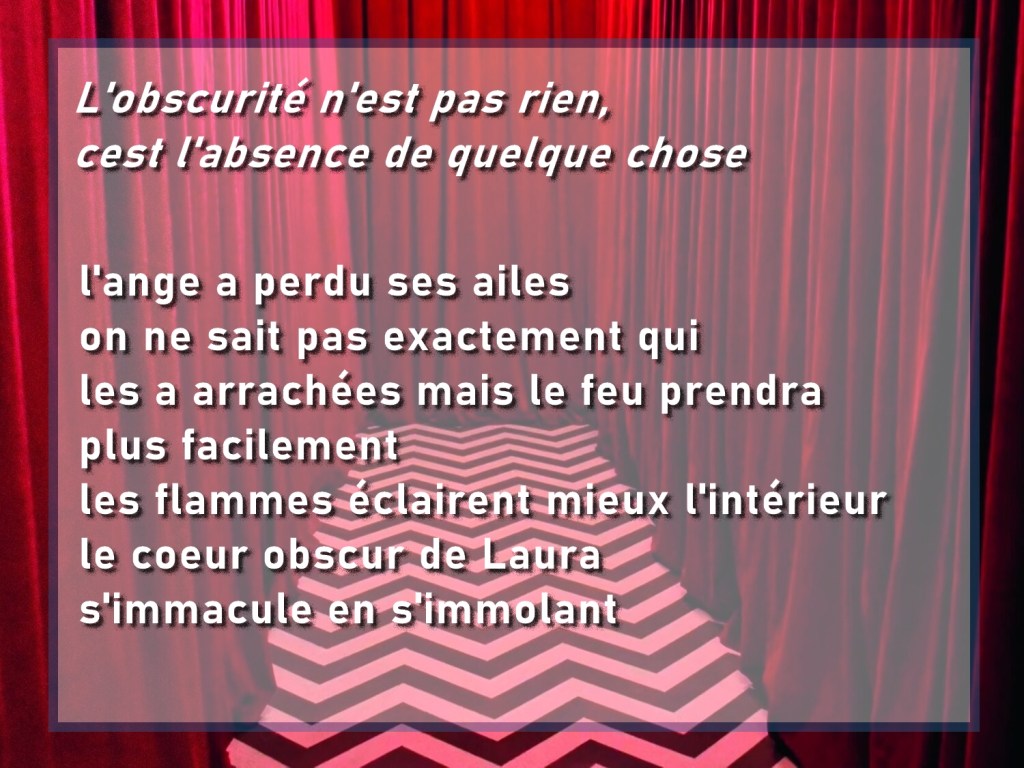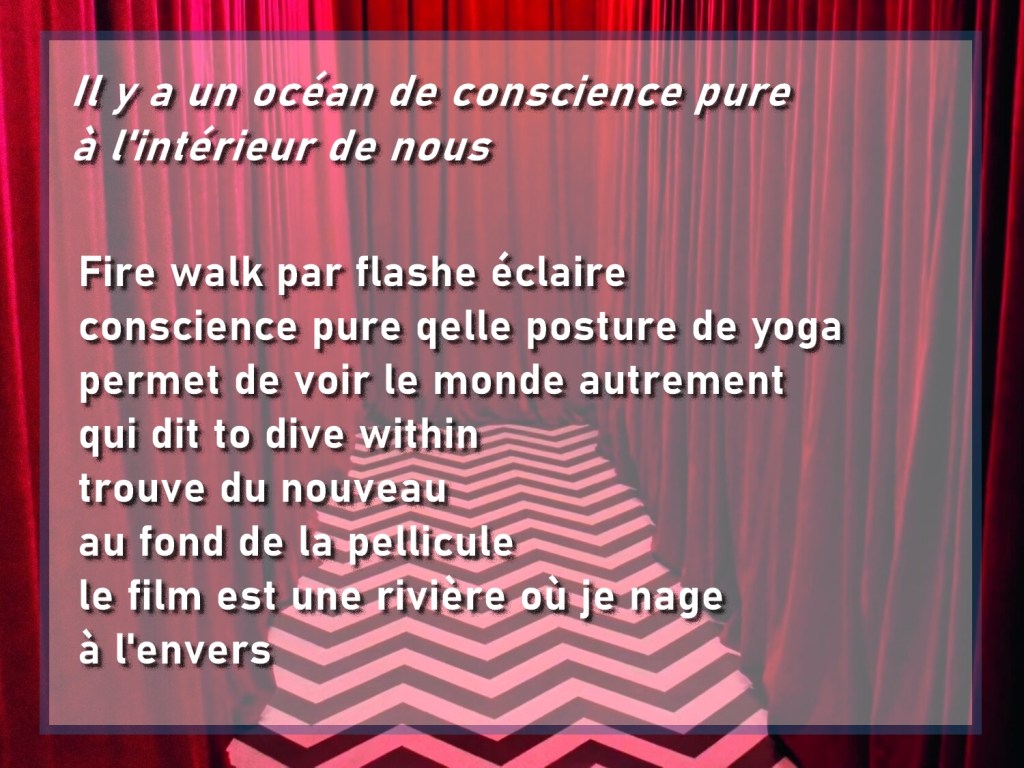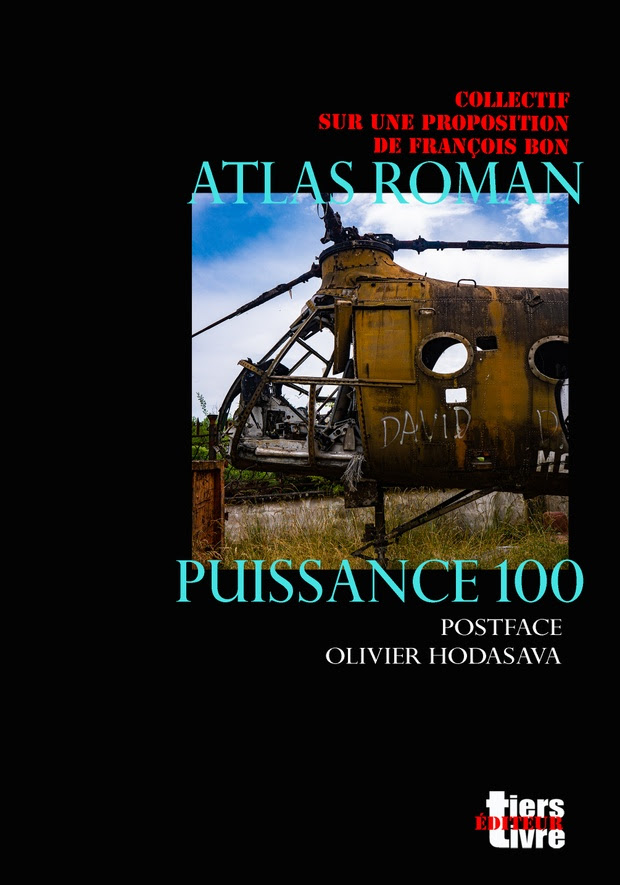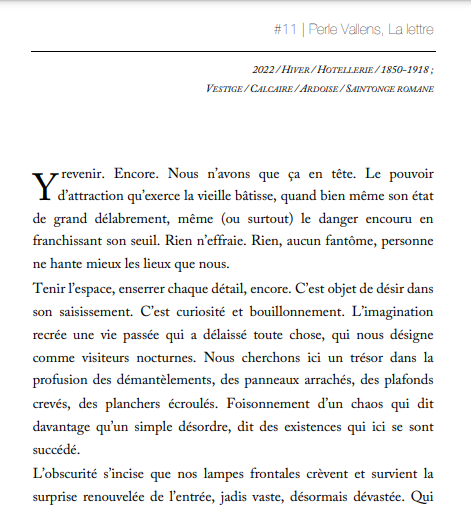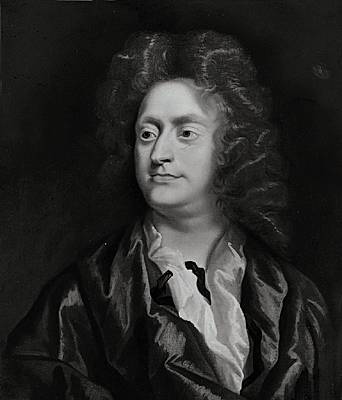On l’a dit fougueuse, nerveuse, sanguine, rebelle, irréversible. On a dit l’animosité familiale. on a médit sa liaison, son travail. Elle a trimé, elle est allée sur les chantiers, a porté lourdes charges, a ramassé l’argile. Elle a trimé pour lui avant de penser à elle, à sa vocation, sa vie.
Il disait qu’il lui avait montré comment trouver l’or mais elle n’avait besoin de personne. Elle a su seule modeler, faire saillir, un trait, un regard. Elle a su seule évider, creuser, polir, trouver la lumière qui se dissimule dans la pierre. Elle n’a jamais eu besoin de lui pour ça. C’est de son amour qu’elle avait besoin. Il disait qu’elle était tout, sa part de ciel en ce bas monde. Après il a pleuré, c’est vrai, cet ours, ce colosse. On lui a conté les larmes, les regrets. Il a pleurée celle qu’il aime. Mais il l’a abandonnée.
Dire qu’elle s’est humiliée, à genoux comme son implorante qui lui a donné tant de fil à retordre.
Dire que la nuit, elle couchait nue pour mieux penser à lui. Elle faisait semblant de croire qu’il était là, avec elle. Mais rien sinon l’absence, le silence de pierres charriées, la blancheur du marbre dans le blanc de l’œil, son éclat partagé à même la fange. L’absence est l’abcès qui crève son cœur, qui ronge son esprit.
Il disait partout qu’elle était folle. Sieur la Fouine et consorts, tous ces marchands d’art qui se sont détournés. Sauf Blot qui lui a pris onze œuvres pour sa galerie.
Elle ne vivait pas de son art. Elle était terrassée par ça. Une douleur ou un affront.
Crachant sur les crevures. La bande à Rodin.
Et pas le sou pour vivre.
Son frère l’adorait, pourquoi donc l’aurait-il fait enfermer avec des folles ? Elle n’était pas folle. Elle était juste très fatiguée. Toute la journée, c’était simagrées et grimaces, et hurlements, et verbiages sans aucun sens, et silence. Encore et toujours ce silence intérieur. Si seulement elle avait eu de quoi sculpter. Mais ici rien, ni édredon, ni seau hygiénique, chambre vide de misère et de froid. Elle était frigorifiée, et ce n’étaient pas les mauvaises soupes qui pouvaient la réchauffer ou la nourrir. De quoi l’accusait-on ? D’avoir vécu seule avec ses chats, d’avoir la manie de la persécution. Ce qu’on ne dit pas, peut-être ce qu’est péché à expier : avoir avorté.
Elle a supplié sa mère. Elle a supplié Paul. Jamais ne perdait espoir, écrivait, suppliait. Elle pensait toujours qu’il allait la faire sortir d’ici, la reprendre. Au pire elle serait allée à l’hôpital ou au couvent. Ils l’ont tous abandonnée, tous rejetée. Jetée en cachot parce que cette soit-disant chambre ou une geôle, c’est du pareil au même. Ici est immense solitude. Ici est un gouffre où elle est enterrée vive. Là où elle tangue, elle s’accroche à l’idée de liberté comme une branche qui ne fait que ployer, jamais ne rompt. Vingt ans qu’elle ploie avec elle. Ployée jusqu’à la fin, de plus en plus tassée sur elle-même.
Ses mains sont tombées, inertes. Mains coupées du corps. Ses mains de bataille ne taillent plus. Ses mains scribouillardes en vain. Ses mains incarcérées. Mais ses mains de précision, de joaillière ont tissé l’œuvre, ont pétri la peau dans la matière brute. Les mains ont fini par fusiller les regards critiques, les voix critiques d’une autre époque. Les mains sont sorties grandies, légendaires de l’épreuve, de la maladie, de l’abandon, de l’enfermement, de la mort. Les mains sont aujourd’hui glorifiées de tant de beauté surgie d’un bloc de pierre froissée. Les mains célébrées : une grâce.
Perle Vallens